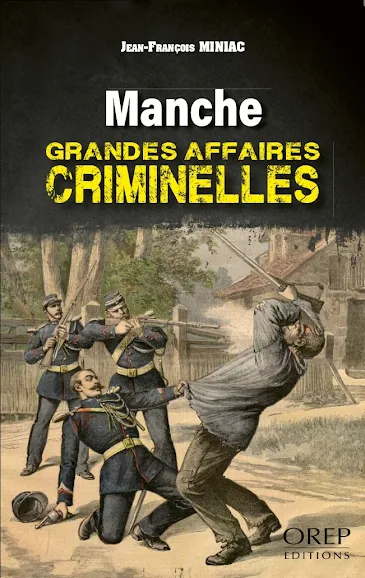Jean-François Miniac
Oreille en coin, main courante et police de caractère...
dimanche
L'Encyclopédie de Saint-Malo
L'Encyclopédie de Saint-Malo, l'incroyable somme signée du Dr Gilles Foucqueron, vient de paraître aux éditions Cristel, fruit de plusieurs décennies de passion pour la question malouine. Cette encyclopédie s'avère être un indispensable pour tous les amoureux et amoureuses du Clos-Poulet ! Ce duo de livres étoffe grandement et actualise une première version parue en 1999 sous un autre titre. Il y a toujours une occasion de se plonger dans cette Bible désormais riche de 2093 pages !
lundi
Littératures & Cetera
Vauban, Le Piège malouin
"Vauban ! Chacun reconnaît le génie militaire du grand ingénieur de Louis XIV. Mais qui connaît l'homme ?.. Alors que l'Angleterre attaque la Bretagne, la mission de défense de Saint-Malo confiée à Vauban se double d'un enjeu personnel, le sort d'un fils caché... Dès lors, l'intime devient le ressort politique d'un thriller historique sur fond de guerre de religion entre catholiques et protestants..."
JFM.
Pourriez-vous évoquer la genèse de la série ?
JFM : Initialement, la paternité de l'idée revient à notre éditeur, Nicolas Anspach. C'est en visitant le château ardennais de Bouillon lors de la parution de la BD « Godefroy » que Nicolas en a eu la révélation. Comme une évidence. Tout un chacun connaît Vauban, et pourtant le territoire était alors encore vierge dans le neuvième art. Alors, il m'a souhaité confier le scénario de ces premiers tomes. De facto, je devais arpenter un territoire connu. Dans certains de mes écrits, j'étais déjà rompu à l'axe narratif qui préside à cette série : l'inclusion d'une fiction dans les failles de l'histoire.
Qui est Vauban ?
JFM : Un nom universellement réputé et un homme méconnu du point de vue personnel, intime. Cela tombe bien, car je me sers de ces interstices de l'histoire pour m'y faufiler et y construire une intrigue.
Vauban, un personnage romanesque ?
JFM : De prime abord, ce n'est pas l'angle qui prévaut quant il est question de ce bâtisseur. Oui, romanesque, et davantage qu'on ne le croit ! C’est précisément notre enjeu. Génie militaire célébré, grand commissaire de l'Etat, Vauban est un serviteur de premier ordre qui arpente le royaume de France pendant des décennies, de chantier en chantier, au gré des affectations. Loin de son essentiel foyer morvandiau par obligation, cet homme-là vit une seconde vie sentimentale, additionnant notamment des aventures amoureuses à en croire la teneur du codicille secret de son véritable testament. Ce premier diptyque prend ainsi racine dans ce codicille dans lequel il demande à ce qu'une poignée de femmes – putatives mères d’enfants - héritent de lui. Dès lors, je m'empare d'un nom, celui de Mme Dietrich, et imagine le destin de son fils, le prénommé Ronan. Or, lors de l'attaque de la célèbre machine infernale sur Saint-Malo en 1693, un homme disparaît, autre faille exploitée...
Tout est imaginaire alors ?
JFM : Pour partie ! L'enjeu autour de Ronan Dietrich relève de la fiction, tout en s'appuyant sur des personnages réels, tous, jusqu'au moindre second rôle.
Pas de références visuelles pour ces personnages…
JFM : Pour la plupart, non. Pour chacun d’eux, j’ai proposé à notre complice Andrea une série de trognes de seconds rôles du cinéma français. Ainsi, Dupuy s’inspire de l’acteur Sacha Pitoeff, Hardy de Charles Denner, Friant de Daniel Emilfork, Bertaudière de Michel Aumont, etc. Pour revenir à la question initiale, c’est paradoxalement l'étude fine des relations sourcées de ces véritables personnes qui permet de donner une couleur authentique au récit, d'émailler celui-ci d'anecdotes et de faits, et surtout qui autorise l'imagination à se déployer dans le cadre strict du carcan historique, à déduire le champ du possible à partir d’un réel attesté. Pour le reste, la part historique du récit, ma rigueur est extrême. Naturellement dans la mesure des sources documentaires, partiellement lacunaires pour ce XVIIe siècle.
Quelles sont vos sources ?
JFM : Pour les faits historiques eux-mêmes, je me suis référé aux relations de première main, à savoir les comptes-rendus de Vauban à sa hiérarchie, comme aux récits de l'époque. Ainsi, les propos de Vauban d'ordre architectural, militaire ou stratégique sont puisés dans ses propres courriers, parfois mis dans la bouche de ses interlocuteurs. Par souci éditorial de s'adresser à un large lectorat, le vocabulaire de Vauban a parfois été modernisé, obéré de tournures jugées aujourd'hui désuètes.
Pourquoi ce choix d'initier la série par Saint-Malo ?
JFM : Un choix tout personnel puisque, d'une famille servannaise depuis la Révolution, j'ai l'histoire malouine à cœur, et particulièrement celle de son ancien faubourg Saint-Servan. Une évidence surtout car, par son chapelet de forts, Vauban a littéralement façonné la baie, la plus belle du monde selon feu Alain Colas. Au XVIIIème siècle, le naturaliste Buffon estimait que le point de vue embrassé depuis la butte servannaise du Gras-Larron était le plus beau panorama en Europe. Il y aura pu admirer les œuvres de Vauban…
Saint-Malo n'est pas le site le plus emblématique de Vauban ?
JFM : Oui et non. Non, car dans la mémoire collective, son nom reste davantage associé à la citadelle de Besançon, à celle de Lille aussi. Aujourd’hui, douze de ses fortifications sont inscrites sur la liste du patrimoine mondial de l'UNESCO : Arras, Besançon, Blaye/Cussac-Fort-Médoc, Briançon, Camaret-sur-mer, Longwy, Mont-Dauphin, Mont-Louis, Neuf-Brisach, Saint-Martin-de-Ré, Saint-Vaast-la-Hougue et Villefranche-de-Conflent. Pour autant, au large de la cité corsaire, le fort de la Conchée était considéré par Vauban comme « la plus belle forteresse du royaume, la plus difficile à bâtir, la mieux entendue », selon ses mots adressés à Louis XIV.
Sans compter la célèbre machine infernale ?
JFM : Exactement ! Cette machination – un navire bourré d'explosifs destiné à embrasser la poudrière de la ville et à anéantir la cité - est un événement emblématique de l'histoire de Saint-Malo, à comparer avec le bombardement sur l'intra-muros de l'été 1944. D'ailleurs, la chanson populaire « La Mère Michel » y ferait référence. Prenant appui sur une source incontestable, un courrier du duc de Chaulnes, j'ai choisi de dater l'événement d'un autre jour que celui communément admis et véhiculé, parti pris d'ailleurs corroboré par Gilles Foucqueron dans son Saint-Malo en l'Isle.
La représentation du nid corsaire relève du défi ?
JFM : J'attache une grande importance à tutoyer la véracité visuelle, à défaut de vérité, songeant toujours à quelque peu satisfaire de rares spécialistes. Un conséquent travail documentaire surplombe notre représentation de Saint-Malo. Un plan précis de la ville a été établi, rue par rue, pour situer les visuels de bâtiments contemporains à Vauban, ceci afin que nos personnages suivent un parcours logique dans la cité, ce dans un décor rigoureusement attesté. Auteur d'un fidèle plan-relief de Saint-Malo en 1758 établi d'après les cadastres, Gilbert Louet nous a aussi livré les vues numériques de son plan dont nous avions besoin, notamment pour Saint-Servan. De même, l'éminent historien de Saint-Malo qu'est le Dr. Gilles Foucqueron a eu la gentillesse de nous accompagner, par ses conseils avisés au fil de la réalisation. Son Saint-Malo, deux mille ans d’histoire est la Bible des amoureux de l’histoire malouine.
La ville a largement été détruite lors de sa libération en 1944...
JFM : En grande partie pour l'intra-muros. Pour autant, Saint-Servan a été grandement épargné. Ainsi, avec Nicolas, nous avons eu le plaisir de visiter longuement la discrète malouinière de la Giclais en compagnie de son heureux propriétaire qui nous a largement ouvert son domaine. Un autre lieu majeur de l'album, l'ancien corps de garde du XVIIe siècle de la cité d'Aleth, a aussi survécu à ces affres de la Seconde guerre mondiale. Alors isolé sur cette presqu'île, la maison était idéale pour situer les ravisseurs et leur otage. Son propriétaire m'a également permis de visiter les lieux pour en comprendre l'agencement intérieur. Cette « maison aux volets bleus », Les Côtières, appartenait jadis à mon arrière-grand-père Paul.
Un mot sur l'hôtel particulier de Vauban à Paris ?
JFM : Oui, cet hôtel est aujourd'hui détruit. Seule une plaque commémorative indique son existence passée sur l'édifice actuel. Et son absence d'iconographie dans la bibliographie sur Vauban était un écueil pour l'authenticité visuelle de notre récit. Or, en fouinant dans les collections d'un musée parisien, j'ai eu la chance de tomber sur une gravure du quartier qui, par récupération, m'est apparu comme représentant également l'hôtel ! Elle constitue aujourd'hui la seule référence visuelle pour cet immeuble, à ma connaissance.
Comment avez-vous procédé pour le mobilier ?
JFM : Hormis ces reportages sur ces deux lieux et quelques références sur le mobilier malouin du XVIIe siècle, le travail documentaire sur les intérieurs, le mobilier, est essentiellement celui d'Andrea, mon complice dessinateur.
Et pour la marine à voile ?
JFM : J'ai également laissé à Andrea le soin de se documenter sur la marine à voile de l'époque. A cet égard, je remercie le dessinateur maritime Franck Bonnet qui a eu la gentillesse de regarder les planches et de prodiguer quelques conseils avisés.
Un mot sur votre collaboration visuelle avec Andrea Rossetto ?
JFM : Des plus fluide, notre collaboration est un plaisir. Ensemble, nous avions déjà travaillé sur deux albums et c'est tout naturellement que j'ai proposé son nom à Nicolas qui a été séduit par son trait réaliste. Nos échanges sont constants, du rough à la couleur. Après validation et ajustement du scénario par l'équipe éditoriale, je fais un reportage photographique sur les lieux puis fournis les roughs à Andrea, ensuite on se consulte à chaque étape, crayonné et encrage. Voire sur la couleur, pour le suivi de nos choix esthétiques et les éventuels ajustements chromatiques.
Incidemment, quelques questions parcourent votre récit ?
JFM : Bien entendu. Le figure de Ronan Dietrich porte la question de la paternité cachée, celle aussi de la culpabilité éventuelle du géniteur, Vauban en l'espèce, celle aussi de la construction individuelle de l'enfant par rapport à cette figure paternelle absente. Ces sujets s'avèrent contemporains, ils peuvent faire échos dans nos sociétés occidentales aux cellules familiales de plus en plus éclatées.
Comme la
question de la religion ?
JFM : Dans ce diptyque, l'autre grande question en filigrane est en effet celle des guerres de religion, en l'espèce entre Catholiques et Protestants. Il est fascinant de constater la similitude des mécanismes humains et sociétaux mises en oeuvre par ces tensions religieuses au XVIIème siècle et celles d'aujourd'hui, notamment autour de la question de l'islam en France et de son dévoiement islamiste.
Un souhait
?
JFM : Plusieurs. Le premier serait que la charte graphique de la collection use des ”13 couleurs de Vauban”, des couleurs authentiques sélectionnées, validées et nommées par l’ingénieur, à destination de la marine royale. Redécouverte par l’architecte naval Jean Boudriot, cette palette officielle de la marine établie sous le Roi-Soleil est aujourd’hui développée par Les Malouinières. Elle est notre référence pour la colorisation des navires français présents dans le tome 2.
Bon vent à
la collection.
JFM : Puisse-t-il nous porter loin. En cours de réalisation graphique, plusieurs autres albums traiteront de nouveaux sites Vauban. Et notamment la fin de ce premier diptyque, prévu également en 2026.
Le 5 septembre 2025.
samedi
Grand Dictionnaire du Vin
La première mouture de la couverture du dictionnaire.
Sous-titré "Histoire, terroirs, usages et plaisirs d'un patrimoine vivant", mon Grand Dictionnaire du Vin sort le 18 septembre 2025 chez Christine Bonneton. Il s'agit de mon dixième ouvrage paru chez cet épatant et fidèle éditeur, plus précisément mon sixième "beau livre". Riche de 356 pages agréablement illustrées et maquettées par le photographe Vivien Therme, sous couverture rigide et en couleur, ce "beau livre" est une plongée au coeur de l'univers hexagonal du vin. Il restructure, enrichit et complète mon France des Vins et des Champagnes, édité également par Bonneton, que je conseille aussi à celles et ceux qui ne le connaissent pas.
Présentation de l'éditeur :
"Cépages, terroirs, appellations, vinifications, arômes, accords mets-vins, traditions régionales, grands domaines, techniques de dégustation... Le vin est un monde en soi, riche d'histoire, de culture et de savoir-faire.
Le Grand dictionnaire du vin en explore tous les aspects, des plus fondamentaux aux plus insolites, à travers des centaines d'entrées claires, rigoureusement documentées et accessibles à tous. Qu'il s'agisse de comprendre la différence entre un chenin et un chardonnay, de découvrir les secrets d'un grand cru classé ou d'explorer les usages des amphores géorgiennes, chaque article éclaire une facette de ce patrimoine millénaire.
À la croisée de la science, de l'art de vivre et de la passion, cet ouvrage s'adresse aussi bien aux amateurs curieux qu'aux professionnels exigeants. Une véritable encyclopédie vivante du vin, à feuilleter au gré des envies... ou à déguster d'un trait.
Un dictionnaire généreux, savoureux et essentiel pour tous les amoureux du vin."
Le Grand Dictionnaire du Vin,
256 pages couleur, format 26 par 17 cm, cartonné.
Catégorie : Beaux Livres.
Editeur : Christine Bonneton eds.
Parution : 9 octobre 2025.
EAN : 9782384871735
Prix : 23, 90 e.